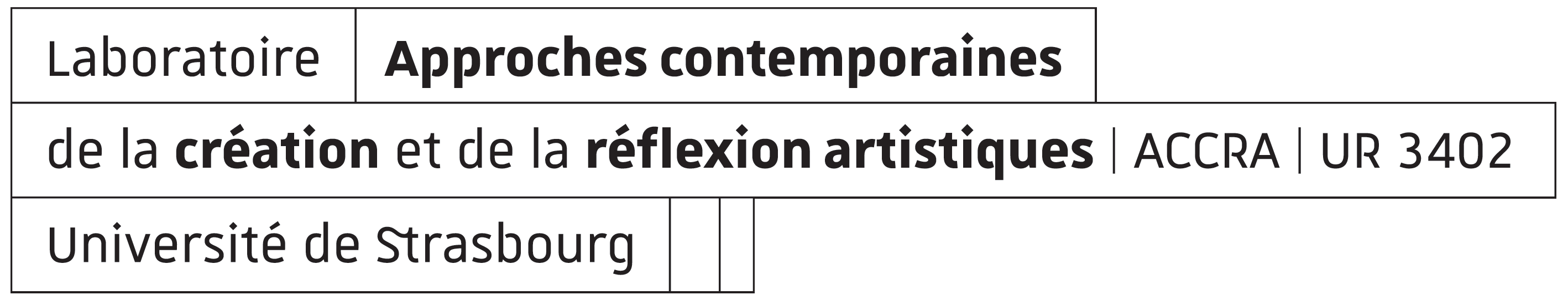Représentations (non)écologiques du numérique
Journée d’études
Le numérique nous apparaît généralement à travers des images, des mots, des pictogrammes, des métaphores ou encore des interactions… Derrière ces choix de design en apparence techniques, il y a une manière très particulière de présenter et promouvoir cet ensemble socio-technique : celle d’un numérique sans matière, sans friction et sans impact.
Pire, le numérique participe à une forme de greenwashing en étant promu comme une solution technique à des problèmes environnementaux via les discours de la dématérialisation et de l’optimisation. Les représentations du numérique se placent ainsi dans la continuité de discours dominants qui reposent sur un optimiste technologique (Strand, 2018). Or ces choix de représentation, qu’ils soient conscients ou pas, participent à développer des imaginaires qui conditionnent la manière dont le numérique est envisagé, conçu et pratiqué. Nous intégrons sous le terme imaginaires autant les perceptions, modèles mentaux et théories populaires (folk theories) du quotidien que les promesses, discours et images de futurs possibles. À mesure que les outils numériques deviennent plus fluides d’utilisation, plus rapides et plus user-friendly, les ressources environnementales (et humaines) engagées pour parvenir à ces résultats sont de plus en plus conséquentes (Magee & Devezas, 2017). Les représentations du numérique participent alors à nourrir un imaginaire largement hors-sol du point de vue de ses impacts environnementaux.
Avec cette journée d’études, nous souhaitons ouvrir la réflexion sur la place du design dans la production de ces représentations, afin de comprendre en quoi elles nous éloignent d’une pratique plus écologique du numérique. En regard, nous souhaitons explorer d’autres voies possibles, d’autres alternatives, dans un travail de “pluralisation des fictions” (Masure, 2017), sans oublier les enjeux qui entourent leur co-existence avec les services numériques déjà implantés.
Recherches existantes
De nombreux travaux ont exploré les imaginaires du numérique développés par les fictions, à l’image de ceux de Lionel Maes (2022) sur les lieux communs de la représentation des ordinateurs dans les films de science fiction, depuis l’informatique dans laquelle on plonge aux ordinateurs qui s’émancipent. Des travaux de sociologie ont également montré les interrelations entre science-fiction et innovation (Michaud, 2011) ainsi que l’influence des imaginaires visuels de la science fiction sur le développement des interfaces (Shedroff & Noessel, 2012). De manière complémentaire à ces travaux focalisés sur les représentations du numérique dans les fictions, nous nous intéresserons ici principalement aux représentations internes au numérique, celles qui s’incarnent dans les choix des interfaces, dans les discours et la communication.
Ces imaginaires s’incarnent en effet jusque dans les choix terminologiques, dont le Cloud est devenu l’exemple emblématique. Lors des journées de travail Tangible Cloud artistes et designers ont démontré l’imposture de ce terme marketing permettant de camoufler la mise en réseaux permanente et l’implantation de data-centers toujours plus nombreux sous l’image légère et évanescente du nuage. À partir de ce terme, c’est tout un imaginaire visuel qui s’est développé, des photos de stocks participant au greenwashing des industriels du secteur (Degoutin & Wagon, 2021) jusqu’aux icônes de nuages encourageant les utilisateurs à stocker le maximum de données dans des serveurs propriétaires (Vitale et al., 2018). Ces imaginaires étant intégrés autant par les personnes qui conçoivent les plateformes numériques que celles qui les utilisent, ils participent à la diffusion de choix non questionnés, comme par exemple la mise en place de paramètres proposant toujours par défaut les modes de consommation les plus intensifs. À l’inverse, les options les plus sobres et économes sont souvent présentées comme des versions dégradées, à n’utiliser qu’en cas de besoin. Ce genre de motifs ou ”patterns” de conception (Brignull, 2013) peuvent être identifiés dans les plateformes numériques ou dans la communication qui les entoure, et témoignent de l’homogénéité de ces imaginaires, qui se traduit en partie par des similarités et des récurrences dans les choix de design.
Néanmoins, la conception de services numérique n’exclue pas systématiquement ces questions de représentations écologiques. Il peut s’agir de la principale valeur ajoutée du service, comme dans le cas des moteurs de recherche “écologiques”, ou d’outils visant à quantifier et visibiliser les impacts des usages numériques d’une personne. Ces services prennent le numérique écologique à la fois comme sujet et comme approche de conception, mais peuvent faire l’objet de critiques, vis à vis des façons d’objectiver le calcul de l’empreinte environnementale d’un usage donné (Cérin et. al., 2023), ou encore concernant l’auto-proclamation de leur caractère écologique (Derrac, 2024). De même, les indicateurs ou labels d’éco-conception numérique sont des manières de représenter un numérique écologique qui peuvent être questionnées. Si tant est qu’un label puisse solutionner les problématiques d’ordre graphique liées à l’identification de services numériques plus écologiques, il est également question de donner à comprendre, de représenter les facteurs pris en compte dans l’octroie du label.
Un numérique écologique peut aussi s’inscrire dans un changement radical de paradigme, passant par des imaginaires nouveaux qui s’affranchissent de certaines attentes orientant les choix de design vers des objectifs d’accroissement de l’engagement des utilisateur·ice·s, ou encore d’évolution perpétuelle des contenus et des fonctionnalités (Preist, 2016). Des organisations militantes produisent par exemple de nouvelles représentations à l’intersections de leurs luttes écologiques et/ou numériques. On peut notamment penser à la manière dont le “permacomputing” (Heikkilä, 2020) convoque un imaginaire issu du monde paysan qui met l’emphase sur la dimension située du numérique. Ces représentations, dans leur rapport de concurrence et de co-existence avec des idéologies rivales, peuvent tendre à se positionner dans la continuité formelle ou au contraire marquer leur indépendance grâce à des représentations radicales.
Ces différents exemples n’illustrent qu’une petite partie des problématiques liées aux représentation d’une écologie numérique. Nous espérons par cette journée d’étude créer des connexions nouvelles entre travaux de recherche sur l’existant et projets explorant des alternatives.
Organisation
La journée d’études se tiendra le mardi 8 avril 2025 dans la salle de conférences de la MISHA de l’Université de Strasbourg, Allée du Général Rouvillois, 67000 Strasbourg et retransmise en ligne
Équipe organisatrice
La journée d’études est co-organisée par Nolwenn Maudet et Anaëlle Beignon, chercheuses dans le laboratoire ACCRA de l’université de Strasbourg et membres du projet de recherche Limites Numériques. La journée d’études s’inscrit dans le programme de recherche Cultures Visuelles de l’ACCRA.
Comité scientifique
Anaëlle Beignon
Margaux Crinon
Timothée Goguely
Nolwenn Maudet
Vivien Philizot
Sophie Suma
Bibliographie
- Brignull Harry. 2013. “Dark Patterns: inside the interfaces designed to trick you”. theverge.com. http://www.theverge.com/2013/8/29/4640308/dark-patterns-inside-the-interfaces-designed-to-trick-you
- Cellard, Loup et Anthony Masure. 2019. “Le design de la transparence : une rhétorique au cœur des interfaces numériques”, Multitudes, no 73, dossier « Tyrannies de la transparence », dir. Emmanuel Alloa et Yves Citton.
- Cérin, Christophe, Denis Trystram et Tarek Menouer. 2023. “The EcoIndex metric, reviewed from the perspective of Data Science techniques”. IEEE 47th Annual Computers, Software, and Applications Conference (COMPSAC), Torino, Italy, 2023, pp. 1141-1146, doi: 10.1109/COMPSAC57700.2023.00172.
- Degoutin Stéphane et Gwenola Wagon. 2021. Atlas of the Cloud, 72 planches, 48x35cm, couleur. Voir : https://d-w.fr/en/projects/atlas/
- Derrac, Louis. 2024. “Ecosia Browser, ou quand le greenwashing numérique fume la moquette tout en plantant des arbres”. louisderrac.com. https://louisderrac.com/2024/04/ecosia-browser-ou-quand-le-greenwashing-numerique-fume-la-moquette-tout-en-plantant-des-arbres/
- Ensmenger, Nathan. 2018. “The Environmental History of Computing”. Technology and Culture 59 no. 4, p. 9.
- Giroud, Guillaume. 2021. « L’interface de la représentation, représentations de l’interface ». Interfaces numériques 10 (1). https://doi.org/10.25965/interfaces-numeriques.4542.
- Heikkilä, Ville-Matias. 2020. “Permacomputing”. viznut.fi. http://viznut.fi/texts-en/permacomputing_update_2021.html
- Maes, Lionel. 2022. “Dive into the Machine”, entretien dans le cadre de “tangible cloud”, sessions de travail de mars à mai 2022 ayant pour but d’imaginer des narrations alternatives au cloud.https://archives.tangible-cloud.be/files/interviews/17_maes.pdf
- Magee, Christopher et Tessaleno Devezas. 2017. "A simple extension of dematerialization theory: Incorporation of technical progress and the rebound effect", Technological Forecasting and Social Change 117, p. 196.
- Masure, Anthony. 2017. “Panne des imaginaires technologiques ou design pour un monde réel?”. Actes de la journée d’étude [«CinéDesign : pour une convergence disciplinaire du cinéma et du design»](http://www.cinema-design.fr/panne-des-imaginaires-technologiques-ou-design-pour-un-monde-reel).
- Michaud, Thomas. 2017. « De la science-fiction à l’innovation technoscientifique : le cas des casques de réalité virtuelle », Innovations no. 52, p. 43-61. DOI : 10.3917/inno.052.0043.
- Preist, Chris, Daniel Schien et Eli Blevis. 2016. “Understanding and Mitigating the Effects of Device and Cloud Service Design Decisions on the Environmental Footprint of Digital Infrastructure”. In Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '16). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 1324–1337. https://doi.org/10.1145/2858036.2858378
- Strand, Roger, Andrea Saltelli, Mario Giampietro, Kjetil Rommetveit et Silvio Funtowicz. 2018. “New narratives for innovation”. Journal of Cleaner Production, 197, 1849–1853. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.10.194
- Vitale, Francesco, Izabelle Janzen et Joanna McGrenere. 2018. “Hoarding and Minimalism: Tendencies in Digital Data Preservation”. In Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '18). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Paper 587, 1–12. https://doi.org/10.1145/3173574.3174161
Organisé dans le cadre du projet ANR suffisance numérique, avec la participation financière de l’ACCRA
Conception graphique: Alice Ricci
Typographie: Libre baskerville, Avara et Sometype mono